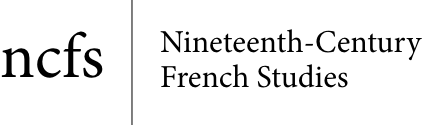Boulard on Wulf (2015)
Wulf, Judith. Étude sur la langue romanesque de Victor Hugo. Le partage et la composition. Garnier, 2015, pp. 598, ISBN 9782812433368
Wulf, Judith. Étude sur la langue romanesque de Victor Hugo. Le partage et la composition. Garnier, 2015, pp. 598, ISBN 9782812433368
Stéphanie Boulard, Georgia Institute of Technology
Victor Hugo est “le seigneur des mots” avait dit Barrès. C’est ce qu’explore et confirme l’ouvrage de Judith Wulf, Étude sur la langue romanesque de Victor Hugo, qui place le langage au cœur de sa réflexion critique et entreprend de donner des clefs de lecture pour aborder les questions sociales, poétiques, historiques, politiques, philosophiques de l’œuvre hugolienne. Tâche ambitieuse pour laquelle elle puise dans tout un arsenal d’outils sémiologiques, linguistiques et narratologiques arguant pour ce faire qu’il existe une “épistémologie de la langue chez Hugo” sur laquelle “il réfléchit souvent de manière très technique” (28), afin d’ancrer sa réflexion sur l’affirmation hugolienne: “La forme et le fond sont aussi indivisibles que la chair et le sang” (289).
Le livre se compose de quatre parties, successivement intitulées “Le rouage du roman,” “Les contraintes du verbal,” “Le style comme mode de vivre” et “Portée romanesque.” Wulf analyse la force des romans de Hugo en étudiant les paradoxes du style hugolien, et en réfléchissant sur les lois de la composition romanesque qui reflètent, à leur tour, le principe dynamique du monde, partant de la formule même de Hugo “le livre est un engrenage […] les idées sont un rouage” (33).
Entrer au cœur de l’univers hugolien, oui, mais dans “le tourbillon des énonciations hétérogène du texte” (26), et par ce que Wulf appelle l’“écriture concrète” (64) de Hugo. C’est-à-dire en juxtaposant et analysant méthodiquement, par exemple, l’utilisation de la métaphore qui “spatialise” la pensée (65), les prépositions “pivots” tel “de,” l’utilisation du démonstratif, de la métonymie-synecdoque, des répétitions, ou encore de l’agencement typographique du texte.
Or, la démonstration critique du livre est inégale. Dans la tentative de saisir la dynamique de la pensée hugolienne, on peut se laisser convaincre par l’analyse du débordement du signifiant par le signifié dans l’utilisation hugolienne de la périphrase qui, pour reprendre le mot de Michel Deguy, “tourne autour du singulier” (79). On peut aussi, sous ce que Wulf appelle l’“hétérogénéité en exil,” apprécier son analyse des contradictions concret/abstrait, l’importance des lieux de frontière et, avec eux, le seuil, la marge, l’altérité, l’étrange, à quoi s’ajoute le monstrueux, la difformité, la barricade. Mais, si son analyse de l’ancrage textuel de la négativité chez Hugo, ou ce qu’elle appelle la stratégie déceptive, donne, outre les règles de formation syntactico-sémantiques, des outils d’analyse qui permettent au lecteur d’appréhender des phénomènes de rupture dans la continuité des textes—et donc d’envisager ellipses, brisures, titres déceptifs, digressions, etc.—l’analyse elle-même manque d’inclure la réalité conflictuelle, dynamique, politique de l’œuvre qui est bien ce qui donne sens à la forme. Elle évoque l’évidence de la remise en cause de l’ordre dans les romans hugoliens et mentionne la pensée comme effraction. Certes, pour Hugo, “réintroduire l’extraordinaire dans le roman apparaît comme une urgence démocratique” (113). Mais il faut plus que mentionner “le grondement de l’histoire toute proche” (113) pour rendre compte de toute la subversivité de la pensée historique, politique et philosophique hugolienne.
Car la question de l’accès d’une œuvre, et celle de Hugo particulièrement, n’est pas distincte de celle de son sens. Il y a une cohérence organique, un contenu à saisir dans son engrenage qui dépasse l’analyse successive et indifférenciée des fragments, des objets, des thèmes ou des synonymes. On a donc du mal à suivre l’auteur dans ses assertions: “il n’y a pas de relation d’adéquation entre un signe et une idée,” “les signes sont présents partout mais ne signifient rien, ou plutôt ils signifient le rien,” “le sens ne peut se situer au niveau du mot.” Comment comprendre, alors, par exemple, la place centrale, essentielle, dans toute l’œuvre romanesque hugolienne du seul mot ANANKÈ?
On voit bien que l’auteur veut nous emmener du côté du polysémique, ou du poétique. Car les mots se divisent, se dédoublent pour mieux se confondre, ont des contrecoups, développent des résonances en échos. Or, c’est bien dans le corps à corps premier au mot que surgit le cœur de la pensée de Hugo—le coup de plume oxymorique, symbolique, métaphorique, fabriqué, du virtuose de la langue qu’est Hugo ne fait que l’engager ensuite plus avant dans le jeu de la littérature. Ainsi, comme l’a montré Jean Maurel que cite Judith Wulf, “le promontoire, c’est, en grec, le problema” (315). Or, ce n’est pas, comme elle l’écrit, “le symbole même du problème de la forme” (315), mais bien celui du fond. Le “promontoire de la pensée” ou “du songe” hugolien reprend, en effet, l’idée du “problème” que l’on projette en avant pour se défendre, c’est-à-dire que c’est le continent de la pensée poussé à sa frontière, jusqu’à sa limite. Le songe ou le rêve n’intervient donc pas dans l’œuvre hugolienne, comme l’affirme l’auteure, “lorsque la pensée n’est plus possible” ou “lorsque la situation devient trop complexe pour [l]a pensée” (183), mais bien comme le fil nécessaire de la pensée qui nous oblige à en suivre la précipitation.
Il y a de très bonnes analyses et des pistes de réflexions originales mais qui s’emmêlent parfois de façon répétitive sans donner de sens politique, philosophique ou historique éclairant à la forme. Toutefois, tout admirateur de l’œuvre hugolienne ne pourra manquer d’être sensible à l’exploration des subtilités de la langue de Hugo que propose Judith Wulf, tout comme les belles formules très “hugoliennes” qu’elle choisit pour certains de ses sous-titres: “Machine matrice,” “Nécessité du contour” ou encore “L’architecture de la mer.” À coup sûr, nous nous laissons prendre par les mots, car ce sont eux qui, comme Lucrèce, nous dit Hugo, défont “l’amarre qui ouvre l’espace ouvert du songe.”