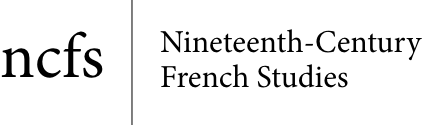Thériault on Saint-Amand, ed. (2016)
Saint-Amand, Denis, éditeur. La Dynamique des groupes littéraires. PU de Liège, Collection “Situations,” 2016, pp. 190, ISBN 978-2-87562-104-7
La dizaine d’études réunies par Denis Saint-Amand propose une saisie à la fois descriptive et historique des groupes littéraires, à travers les diverses formes et dénominations (école, cénacle, mouvement, réseau…) sous lesquelles ils se manifestent dans la modernité des XIXe et XXe siècles, alors que l’“ère médiatique” et la dynamique des avant-gardes leur confèrent une visibilité institutionnelle et une importance symbolique sans précédent. En suivant son objectif directeur, “offrir un espace de réflexion systématique sur la littérature vécue collectivement” (16), le projet s’avère incidemment contribuer au développement (et, sous certains rapports, à l’assouplissement) de la théorie des champs de Pierre Bourdieu et de l’analyse institutionnelle de Jacques Dubois, dont il tire l’essentiel de son inspiration conceptuelle, en faisant notamment une large place aux facteurs d’ordre microsociologique (relations interpersonnelles, modes d’auto-présentation, “conduites de vie,” etc.).
Dérivé pour l’essentiel d’un ouvrage récemment paru (L’Âge des cénacles, Fayard, 2013), l’article d’Anthony Glinoer et de Vincent Laisney qui ouvre l’ensemble constitue un essai de formalisation de la temporalité institutionnelle des cénacles, telle qu’elle rythme, avec ses phases et ses épreuves caractéristiques, l’histoire littéraire du XIXe siècle (mais guère plus avant: après les Mardis de Mallarmé, sous l’effet de l’accélération et de la spectacularisation des moyens de légitimation, l’institution cénaculaire périclite et ne s’impose désormais plus comme la “passerelle ordinaire vers la consécration médiatique et académique” (38)). La sociogenèse ainsi esquissée a valeur, sinon de paradigme, du moins de point de référence pour plusieurs autres contributeurs. C’est le cas de Michel Lacroix, qui suggère un léger réaménagement de son quadrillage à la lumière de l’histoire des revues québécoises, en soulignant que cette histoire a la particularité d’être marquée par une “hantise de la chapelle” (129) et un refus du dogmatisme s’harmonisant mal avec le scénario idéal-typique de la consolidation du groupe autour d’un leader charismatique. De même, l’étude que David Vrydaghs consacre à René Crevel, surréaliste intermittent, suscitant tour à tour l’admiration et la suspicion d’André Breton et de ses affiliés, fournit un judicieux contrepoint aux tentatives de systématisation du phénomène groupal: elle invite à ne pas négliger les trajectoires atypiques des “outsiders” et, corrélativement, à ne pas réifier les dynamiques collectives à l’œuvre au sein des groupes littéraires en principes universels.
Sur le plan du corpus, l’ouvrage a l’avantage de couvrir une aire culturelle assez vaste (France, Belgique et Québec) et de bien échelonner ses thèmes le long de l’axe historique choisi. Si, comme de raison, la seconde partie du XIXe siècle soulève le plus d’attention, la pluralité des perspectives permet d’éviter les recoupements. Brossant le tableau de cette période, le long essai de Joseph Jurt sert ainsi de toile de fond à une série de contributions plus ciblées. Paul Aron s’intéresse aux symbolistes belges en mettant en relief, au-delà de la spécificité de leurs positions littéraires et culturelles par rapport à celles de leurs homologues français (pratique de l’écriture théâtrale, intérêt pour l’art social, affinités avec le socialisme, etc.), l’indissociabilité de ces positions: du fait que l’espace social belge est étroit, mais très divers et cohésif, l’écrivain est amené à y partager la sphère d’activité non seulement de l’artiste, mais d’une multitude d’acteurs de la vie culturelle et du monde professionnel, quand il ne cumule pas lui-même plusieurs rôles, à l’exemple d’Émile Verhaeren. En plus de redéfinir, dans un sens moins isolationniste, l’idée que l’on se fait de la “constellation” symboliste, la démonstration rappelle qu’on ne saurait déterminer de manière satisfaisante les principes de formation et de cohésion des groupes littéraires sans considérer avec amplitude l’histoire sociale du monde culturel. Daniel Grojnowski profite de son intime connaissance de la modernité pour isoler trois groupes parisiens des années 1880–1900 et réfléchir à leurs modes de légitimation. Il dispose en une forme de chiasme les Zutistes, dont le regroupement éphémère n’est guère attesté que par leur “album,” d’ailleurs longtemps resté secret, et les Hydropathes, lesquels, pour avoir joui d’une certaine longévité (1878–80) et avoir incontestablement échappé à l’oubli, n’ont toutefois laissé aucune œuvre marquante. Les Incohérents, animés et presque résumés par Jules Lévy, complètent le tableau.
Par delà leurs nombreuses différences, ces groupes—qu’on peut concevoir plus souplement comme des “fraternités” (94), compte tenu de la labilité et de la fragilité de leur tissu conjonctif—ont en commun de donner lieu à une forme de littérarité et de sociabilité contestataires, d’inspiration diversement sacrilège ou bon enfant. Caroline Crépiat enrichit la description historique de ce groupisme fin-de-siècle par référence au Chat Noir, alors qu’Antoine Piantoni fait saillir les tendances antiautoritaires qui le travaillent de l’intérieur et qui trouvent à se manifester avec force, selon des modalités propres il est vrai, chez les poètes fantaisistes, au début du XXe siècle. La formation fantaisiste, qu’on aurait de la peine à placer sous la tutelle d’un véritable chef de file, malgré les efforts rétrospectifs de Paul-Jean Toulet pour s’imposer et se légitimer dans ce rôle, témoignerait en ce sens de l’émergence historique du groupe “envisagé comme structure paradoxalement dépourvue de structure” (110).
Tout autant que la question de la définition sociologique du groupe (à laquelle revient aussi Gérard Purnelle en abordant le réseau de poètes s’étant développé autour de la personne de Jacques Izoard au milieu des années 1970 sous le label “Groupe de Liège”), la question de sa représentation, si ce n’est de sa reconstruction médiatique, ressort avec évidence de l’ensemble et se détache comme l’un des aspects critiques les plus déterminants de la réalité groupale, à plus forte raison dans le contexte du XXe siècle. C’est ce que suggèrent la contribution d’Olivier Lapointe sur la couverture médiatique de la fondation de l’Académie canadienne-française et, plus encore, celle d’Aline Marchand, qui analyse les “moments de cristallisation” institutionnelle (155) à travers lesquels les écrivains du Nouveau Roman—favorisés par l’éditeur Minuit et par le colloque de Cerisy de 1971, de fait passé à l’histoire—ont pu trouver l’apparence d’une certaine unité, en dépit des forces centrifuges les poussant à l’individualisation, et occuper en tant que groupe le devant de la scène littéraire des années soixante et soixante-dix, avant de s’installer pour de bon dans l’imaginaire collectif. Dernière avant-garde littéraire, dit-on souvent à son propos, le Nouveau Roman apparaît surtout, à la lumière de cet ouvrage bien conçu et scientifiquement bienvenu, comme la maximalisation symbolique de près de deux siècles de stratégies institutionnelles et de bons coups médiatiques mis en acte au nom, ou du moins sous le nom, du groupe littéraire.