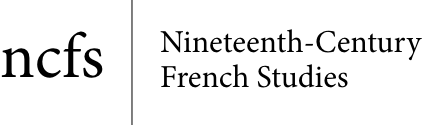Montbazet on Chrastil (2023)
Chrastil, Rachel. Bismark’s War: The Franco-Prussian War and the Making of Modern Europe. Basic Books, 2023, pp. 512, ISBN: 9781541604094
L’historienne américaine Rachel Chrastil offre ici, après ses ouvrages Organizing for War: France, 1870–1914 sur la préparation de la Grande Guerre et The Siege of Strasbourg, publiés respectivement en 2010 et 2014, une synthèse très complète de la guerre franco-prussienne. Dans une narration riche et bien menée, elle y expose l’importance de ce conflit dans la transition entre les conflits du XIXe siècle et la Grande Guerre, tout en en rappelant l’épaisseur historique. Pensé pour un grand public, l’ouvrage vient sans nul doute combler un vide pour le lectorat anglophone qui ne disposait pas de synthèse sur ce conflit depuis l’œuvre classique de Michael Howard remontant à 1961 et celle plus récente de Geoffrey Wawro en 2003. Il était devenu nécessaire d’y intégrer les évolutions historiographiques des dernières décennies, bien que l’appareil de notes, allégé sans doute pour raison éditoriale, ne le laisse guère transparaître.
Contrairement à ce que son titre laisse penser, le livre laisse à sa juste place la figure du chancelier prussien, loin du marionnettiste des relations internationales qu’on a voulu voir parfois. L’ouvrage entrecroise bien la grande diversité des acteurs de ce conflit, dans une narration globalement chronologique. Les premiers chapitres s’ouvrent sur la déclaration de guerre, dont l’autrice traite les raisons et les enjeux sans en oublier les échos internationaux à une période où télégraphes et agences de presse ont donné naissance à une véritable opinion publique internationale, puis poursuivent sur la mobilisation militaire et la première phase du conflit, des batailles de Woerth-Froeschwiller jusqu’à Sedan. Comblant un manque de son précédent livre sur le conflit, Chrastil accorde une grande place aux questions proprement militaires: manœuvres, armement, logistique, commandement.
Les chapitres suivants exposent la manière dont une guerre qui pouvait apparaître comme purement dynastique a pu évoluer vers un conflit national. Le sursaut organisé par l’énergie d’un Gambetta et l’expertise logistique d’un Freycinet est bien décrit, de même que ses échecs répétés face à la machine prussienne et aux erreurs stratégiques du commandement français. L’occupation militaire d’une grande partie du pays, ainsi que les sièges successifs occasionnés par l’avancée allemande sont l’occasion de développements intéressants sur la question des négociations entre autorités civiles et militaires, sur la gestion des prisonniers comme la médecine de guerre. L’émergence d’une conscience humanitaire, bien connue de l’autrice qui en avait fait un des thèmes centraux de son livre sur le siège de Strasbourg, donne de très belles pages. Les derniers chapitres referment progressivement la séquence chronologique du conflit, traitant de la construction politique, au fil de l’eau, de l’unité allemande, ainsi que des débats occasionnés par les négociations de la paix.
L’épilogue de l’ouvrage conclue sur les perspectives ouvertes par le conflit et renvoie au sous-titre même de l’ouvrage, “The Making of Modern Europe”: le triomphe d’un modèle administratif et militaire prussien, la question des affrontements nationaux et de la mobilisation comme de l’investissement croissant des États vis-à-vis des civils (exagérant au passage peut-être un peu la militarisation de la jeunesse française dans les décennies suivantes). Quelques paragraphes sont aussi consacrés aux mémoires du conflit de part et d’autre de la nouvelle frontière, qui accordent une place différente aux civils et à leurs souffrances.
Ces derniers occupent, comme dans son précédent ouvrage sur le siège de Strasbourg, une place importante de la narration. Une problématique est en effet au cœur de l’ouvrage: comment les civils ont-ils été, en 1870-1871, impliqués dans la guerre? De nombreuses pages sont ainsi consacrées à leur vécu, leurs choix, leurs difficultés et leurs représentations culturelles du conflit. Le fait militaire même tend alors à faire des civils un enjeu tactique et stratégique, en particulier dans le cadre des sièges de ville et des bombardements. Le sujet était devenu sensible du fait de réseaux transnationaux, humanitaires, journalistiques ou religieux capables de mobiliser l’opinion publique internationale. La peur des francs-tireurs et du civil en armes, érigée en véritable doctrine militaire du côté prussien, a ainsi donné lieu aux exactions de Bazeilles ou Châteaudun, dont la construction comme objets d’indignation en France et à l’étranger est bien décrite. Les questions de genre sont aussi largement traitées tout au long du livre: l’engagement des femmes, longtemps occulté du récit dominant, est remis à sa juste place, qu’il soit dans le domaine militaire comme cantinières, ou à l’arrière dans les questions d’approvisionnement, de soin et de charité.
On notera cependant que ce traitement de la question des civils dans la guerre est marqué par un net tropisme culturel, qui tend à mettre de côté les apports d’une histoire plus sociale. La notion d’ “opinion” est ainsi peu questionnée, prise parfois comme une pièce parmi d’autre du puzzle géopolitique ou comme acteur collectif indéterminé, lors de la déclaration de guerre (“Most, however, followed the tide of public opinion” 8) ou dans le contexte de Paris assiégé (“Parisians invented heroism for themselves through their writing and observations […] [a]nd they made themselves the heroes of the own story” 358). La question de l’engagement, pourtant soulevée dans un chapitre entier intitulé “Choices” manque d’interroger suffisamment la différence des contextes géographiques, économiques ou sociaux présidant à ces “choix.” L’usage des sources y est peut-être pour quelque chose. Malgré quelques inédits (comme les mémoires du prisonnier de guerre Sylvain-Paul Olivier) et la volonté d’équilibrer le récit par l’utilisation de témoignages allemands (surtout celui du bavarois Dietrich von Lassberg), la documentation reste dans l’ensemble classique (par exemple George Sand ou Juliette Adam), et mériteraient parfois une interprétation moins littérale et psychologisante, questionnant davantage les auteurs et les contextes de production, en distinguant entre récits reconstruits, témoignages destinés à la publication ou correspondances privées. Malgré ces quelques réserves, on reste en présence d’un livre dense, à jour et bien écrit appelé à faire date pour le lectorat anglophone.