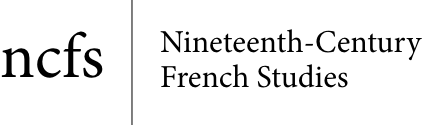Bernadet on Acquisto, Paliyenko, and Witt, eds. (2015)
Acquisto, Joseph, Adrianna M. Paliyenko, and Catherine Witt, editors. Poets as Readers in Nineteenth-Century France: Critical Reflections. Institute of Modern Languages Research, School of Advanced Study, University of London, 2015, pp. 272, ISBN 978-0-85457-246-5
Les douze contributions qui composent ce volume se donnent d’emblée comme gage épistémologique l’histoire du livre et l’histoire culturelle depuis Roger Chartier jusqu’à Martyn Lyons. Mais alors que de telles enquêtes ont surtout retracé les conditions et les traditions de lecture au sein des milieux ouvriers et paysans par exemple, c’est à une autre tâche que s’assigne l’ouvrage en faisant valoir, aux marges de cette historiographie et des phénomènes de masse qu’elle décrit, l’expérience du poète—lecteur lui aussi, d’un genre très particulier: une expérience fondée en priorité sur un geste de réappropriation critique et créatif, aux sources de l’œuvre.
Il ne s’agit nullement d’ignorer à rebours les cadres sociaux, sinon éthiques et politiques, au sein desquels évolue la pratique ou l’acte de lire chez les écrivains. Au contraire, le corpus mis à l’étude est strictement cadastré, entre la Monarchie de Juillet, au moment où émerge une véritable industrie de l’imprimé, doublée par l’essor de la presse, et la Troisième République. Deux articles célèbres sont convoqués en guise de repères (11): l’un de Charles-Augustin Sainte-Beuve qui introduit le terme de “littérature industrielle” et déplore la dévaluation de l’écrit artistique; l’autre de Marcel Proust (“Sur la lecture”), qui promeut de manière réactive une conception radicalement anti-utilitaire, aussi solitaire qu’inventive de la lecture.
À cet égard, si l’on peut regretter que la période romantique stricto sensu soit peut-être moins frayée (Aimée Boutin, Ellen S. Burt) que les années 1850–80, force est de reconnaître toutefois que Baudelaire, objet de plusieurs essais (Timothy Raser, Catherine Witt, Joseph Acquisto, Helen Abbott), y sert de trait d’union chronologique et esthétique. À ce statut central répondent comme en boucle deux études sur Stéphane Mallarmé. La première signée par Rosemary Lloyd (19–34) montre combien la lecture aux prises avec les genres, les questions formelles du vers, le roman dans sa variante naturaliste en particulier, se situe pour l’auteur à l’origine de rêveries fécondes qui rendent indissociables la critique et son mode d’évaluation de la création théorique. Ce que résumerait à côté des Divagations la notion clef (qui n’est pourtant pas invoquée) de “poëme critique.” Dans une perspective qui croise les postulats de Walter Benjamin et l’héritage déconstructionniste, la dernière contribution, de Kevin Newmark (229–47), relie en un mouvement à la fois traductif et translatif Valéry à Baudelaire par l’entremise de Mallarmé, suivant l’idée que “l’original”—Baudelaire—ne devient reconnaissable et lisible pour Paul Valéry qu’à travers ses récritures (236) sous l’espèce de répétitions-altérations dont, en premier lieu, celle de Mallarmé.
Dans cet ensemble savamment concerté, le dialogue de poète à poète(s) ne se comprend toutefois qu’à partir des fondements anthropologiques de la lecture. Or loin de se résorber dans un usage solipsiste et silencieux, la lecture au XIXe siècle dépend tout autant de lieux et de réseaux de sociabilité (cénacles, banquets, cafés, bibliothèques). David Evans inaugure à ce titre un dossier capital: à l’aide de biographies et de témoignages, il reconstitue au temps des Parnassiens l’importance de la lecture orale des vers au sein des cercles professionnels (par opposition à la version mondaine des salons). Dans cette “sorte de laboratoire” (212) s’exercent des “mécanismes de contrôle” (213) de la qualité littéraire en vue d’éventuelles publications. À l’inverse, au terme d’efficaces comparaisons, entre Marceline Desbordes-Valmore et Amable Tastu (35–52), entre Malvina Blanchecotte et Louise Ackermann (187–206), Boutin et Paliyenko rappellent l’inégale distribution du capital culturel entre hommes et femmes ou, parmi les écrivains femmes elles-mêmes, entre classe ouvrière et milieu bourgeois, soulignant les diverses stratégies par lesquelles en retour ces auteures résistent aux modes de penser masculins et disposent les signaux du savoir dans leurs œuvres.
Witt déplace, quant à elle, la question à un niveau éthique. Reprenant les termes mêmes du procès des Fleurs du Mal en 1857, notamment l’incompréhension stylistique (baroquisme vs réalisme) qui a entouré l’appréciation juridique du recueil, c’est dans la perspective de la satire qu’elle analyse avec minutie “Au lecteur.” À ce stade, l’enjeu—ironiquement énoncé par Charles Baudelaire—concerne l’utopie d’une communauté de lecteurs, variablement décrite à travers les réceptions-traductions des œuvres. Car c’est d’abord dans l’espace trans-national qu’elle s’établit, entre Gérard de Nerval et George Sala d’après Burt (56–61) ou Gautier et Nathaniel Hawthorne selon Acquisto (120–30).
Mais les chaînes inter- voire hyper-textuelles n’y contribuent pas moins, si l’on en croit le paradigme anti-classique qu’instaurent dialectiquement Gérard de Nerval, Baudelaire et Victor Hugo, en proposant une vision de l’île de Cythère tour à tour imprégnée de nostalgie, de culpabilité ou de progrès (Raser 76) ou les violentes discordances de la parodie, du “Sonnet du trou du cul” ciblant Albert Mérat (Robert St.Clair 159–67) à Paul Verlaine compétiteur des dizains façon François Coppée (Nicolas Valazza 169–85).
Du reste, ce parcours remarquable demeurerait incomplet si, à côté des lectures déformantes aux trangressions érotiques explicites, il n’y avait place enfin pour la délecture ou la mélecture (“misreading”), comme le fait valoir Abbott (132–37) en regardant vers Baudelaire et la transposition de ses textes dans le domaine musical et la chanson populaire contemporaine.