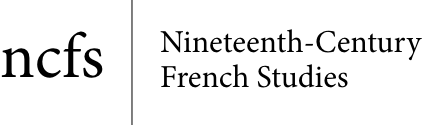Oikonomopoulou on Brix (2021)
Brix, Michel. Du classicisme au réalisme: une histoire de la littérature française (XVIIe–XXIe siècles), Éditions Kimé, 2021, pp. 348, ISBN: 9782380720259
L’ouvrage ambitieux de Michel Brix, historien de littérature, auteur de plusieurs ouvrages de critique littéraire, directeur de recherches à l’Université de Namur et membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique, tente d’explorer la contribution majeure de deux mouvements littéraires, à savoir le classicisme et le réalisme, dans la configuration et l’évolution de l’ensemble de la littérature française dès la fin de la Renaissance et jusqu’à nos jours.
À la croisée de la théorie, de l’esthétique, de la poétique et de l’histoire littéraire, le livre de Brix permet de situer de manière approfondie et audacieuse la production littéraire française des cinq derniers siècles dans un réseau de création où la bifurcation classicisme/réalisme se dévêtit de son optique austèrement diachronique et délimitée, et acquiert les dimensions d’une orientation auctoriale majeure et d’une base pragmatique et herméneutique rigoureuse.
Dans ce cadre, le théoricien belge construit son analyse autour d’une thèse à double niveau: d’abord, il part du concept que le classicisme, dont le trait caractéristique principal est son recours constant aux lettres helléniques et plus précisément à la Poétique d’Aristote, oriente ses lecteurs vers une vision moralisatrice et universalisante de l’existence humaine et du monde qui l’entoure. Aux antipodes de ce mouvement esthétique, thématique voire philosophique se trouve le réalisme qui inaugure avec Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau une déconstruction créative et évolutive de ce premier régime. Il paraît ainsi que le réalisme introduit de nouvelles orientations d’écriture, où les agents de son identité et de son émergence—auteur, œuvre et lecteur—se trouvent revalorisés par le triptyque suivant: primauté du Moi/reconsidération de la vraisemblance en sa relation avec le vrai et la vérité/signification autotélique de l’Art.
L’ouvrage est structuré en sept chapitres, suivis d’une dernière partie non numérotée, sous forme de conclusion qui, sans clore la réflexion de l’auteur, offre au contraire un horizon très ouvert en problématiques sur l’avenir de la littérature. L’ensemble du volume est complété par une bibliographie très riche et un index des noms propres.
Dans le premier chapitre de son ouvrage, intitulé "L’esthétique classique," l’auteur propose une réflexion rigoureuse et argumentée sur les aspects significatifs du registre esthétique classique de la littérature française par rapport à la théorie aristotélicienne, qui les résume en six points (28–40). On y distingue la volonté de l’auteur classique de persuader son lecteur des idées présentées dans son œuvre, et de s’abstenir de tout projet de simples descriptions de la personnalité de ses héros qui, la plupart des fois, sont des protagonistes hors-commun; l’effacement de la voix auctoriale et l’interdiction de toute tentative d’autoréférentialité du créateur; l’évocation des époques lointaines qui instaurent des distances bien distinctes avec le présent de l’inspiration et de l’écriture de l’œuvre; l’enthousiasme que l’auteur doit éprouver face au processus de l’écriture littéraire et, finalement, l’installation d’une critique littéraire sentencieuse et absolue, au dépit de ses formes herméneutiques ou polyvalentes.
Le deuxième chapitre du livre porte le titre "À quoi sert la littérature? La réponse des Classiques." Brix y examine la portée téléologique des œuvres de la littérature classique française. Il met l’accent d’une part sur l’importance de l’allégorie pour la configuration d’un message didactique sur la condition humaine, et de l’autre côté sur la notion majeure de l’hubris qui prévient les humains à priori ou qui les punit à posteriori, dans le cadre de son fonctionnement en tant que facteur de conservation ou de restauration de l’ordre humain.
Portant le titre métaphorique et éloquent "Détricotage de l’esthétique classique et fondation du réalisme," le troisième chapitre du livre accorde une place particulière au passage du registre classique à l’esthétique réaliste, et aux nouveaux défis de l’écriture littéraire qui inaugurent de leur côté la modernité dans le domaine des lettres. S’abstenant de cibler le XVIIIe siècle comme la période historique par excellence d’idées, Michel Brix propose ici sa reconsidération en tant que cadre chronologique de ce revirement observé dans l’esthétique et la poétique littéraires. D’autre part, l’auteur approfondit l’identité des mécanismes qui ont contribué à la mise en relief de cette évolution transformatrice significative. On y reconnaît des éléments tels que "l’abondance de la production romanesque" (73), la prépondérance accordée au véritable et non pas au vraisemblable, la perception des liens inextricables entre le produit littéraire et l’ensemble de circonstances de sa réalisation, dorénavant ancrée dans son époque. Mais c’est surtout cette émergence d’un Moi, à l’instar de l’originalité novatrice rousseauiste, qui dépasse la particularité de simple témoignage narratif et autoréflexif, et qui aboutit à ce qu’"il mesure de tout, tire la loi morale de lui-même et justifie tous les combats" (91).
Suit le quatrième chapitre intitulé "Sa Majesté le Moi," où l’auteur développe davantage la problématique majeure de son ouvrage, à savoir que le réalisme, marqué abondamment par la prépondérance du Moi, ne correspond pas uniquement à une période chronologique bien déterminée, mais il "englobe en fait tout le siècle, depuis le romantisme (et même le pré-romantisme) jusqu’au naturalisme et au symbolisme" (109), alors que son impact se poursuit au XXe siècle.
Citant comme titre du cinquième chapitre de son ouvrage la fameuse phrase de Denis Diderot reprise par Gérard de Nerval dans Nuits d’octobre "Qu’est-ce que cela prouve?", Michel Brix propose ici une nouvelle étape de sa réflexion, centrée sur les tendances narratives et esthétiques de réconciliation entre classicisme et réalisme chez des écrivains du XIXe siècle.
Dans le chapitre suivant de l’ouvrage qui s’intitule "Flaubert et les adorateurs de la phrase," l’auteur procède à une analyse développée de nouveaux enjeux de l’écriture réaliste repérés à partir du milieu du dix-neuvième siècle. Esquissant comme modèle de sa réflexion l’écriture flaubertienne, il démontre de façon très pertinente que les auteurs de cette période proposent une nouvelle perspective de la production auctoriale qui, refusant à priori toute utilité du produit littéraire, elle "rejoint ce qu’on appelle l’art pour l’art, et qui est “fondée sur le thème de l’autotélisme des œuvres d’art" (219).
Titré "XXe-XXIe siècles: sous la tutelle du réalisme," ce chapitre constitue un parcours analytique sur les XXe et le XXIe siècles littéraires, qui continuent à subsister sous l’égide d’une orientation poétique toujours liée au réalisme et sa marque de modernité, mais plusieurs fois "hybride" (251), puisque météorisée entre celui-ci et les échos du classicisme.
Dans la dernière partie de son livre titrée "Le Réalisme, et après?", l’auteur multiplie ses réserves sur la suprématie du réalisme chez quelques écrivains de notre époque, étant donné qu’il semble acquérir les dimensions d’une véritable prison, narrative, thématique, poétique et autoréférentielle, et où le Moi et l’écrivain sont les compagnons de la même cellule auctoriale.
La portée de l’ouvrage que livre Brix sur le classicisme et le réalisme dépasse largement les dimensions d’une simple étude diachronique sur la réception du registre classique et de l’esthétique réaliste chez quelques auteurs français de l’époque moderne. Doté d’une argumentation riche et solide, fondé sur un panorama extrêmement varié de références à des œuvres littéraires du dix-huitième au vingt-et-unième siècles, son livre propose une optique totalement novatrice, originale, sinon transgressive, sur l’interprétation et la critique herméneutique de la production littéraire française de cette période très étendue. C’est ainsi que, en mettant en lumière par une perspicacité exceptionnelle et une argumentation très bien fondée les impacts profonds du classicisme et du réalisme et leurs reconfigurations chez des auteurs français à travers les cinq derniers siècles, l’auteur de cet ouvrage nous invite à revoir, réviser sinon à modifier de nombreuses idées ancrées sur ces deux mouvements littéraires majeurs de l’histoire de la littérature française.