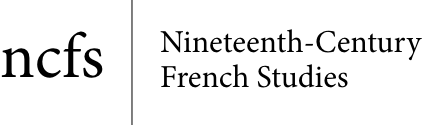Saminadayar-Perrin on Bernard (2021)
Bernard, Claudie. Si l’Histoire m’était contée… Le roman historique de Vigny à Rosny aîné, Paris, Classiques Garnier, 2021, pp. 373, 978-2-406-12186-2.
Avec son ouvrage de référence Le Passé recomposé: le roman historique français du XIXe siècle, Claudie Bernard a offert à la communauté scientifique un précieux outillage théorique et critique pour appréhender l’un des genres majeurs de la modernité post-révolutionnaire. Le succès de la première version de cet ouvrage, paru en 1996 chez Hachette, s’est trouvé confirmé et amplifié par la nouvelle édition, remaniée et mise à jour, aux éditions Classiques Garnier en 2021. Les analyses de Claudie Bernard ont permis à des générations de chercheurs et d’étudiants de penser les modalités et les enjeux de l’écriture romanesque de l’histoire, mais aussi d’en étudier l’évolution dans une période-charnière, où le genre bénéficie d’un prestige épistémologique et esthétique exceptionnel—alors même que son triomphe dans le domaine controversé du roman-feuilleton menace sa légitimité et l’oblige à repenser son discours, ses formes d’expression, ses sujets de prédilection.
Si l’Histoire m’était contée se propose, au travers d’une dizaine d’études de cas, de confronter la carte au territoire, et de mettre à l’épreuve les thèses proposées dans l’ouvrage précédent—dont les lignes directrices et les axes programmatiques sont rappelés en introduction. La démarche révèle un riche potentiel méthodologique et herméneutique. En centrant son analyse sur des œuvres spécifiques, l’auteure opère une contextualisation très précise, servie par une érudition sans faille, qui lui permet de situer chaque roman au sein des débats et de l’interdiscours où il s’inscrit et qui lui donnent sens—en matière de fiction comme d’historiographie, il n’est d’histoire que du contemporain. Par ailleurs, le choix d’envisager chaque ouvrage de manière synthétique et surplombante permet de repérer ce que le discours romanesque doit à la composition du récit, à sa scénarisation et à sa mise en intrigue, aux dispositifs d’ensemble, qui jouent un rôle essentiel et parfois dissonant par rapport aux thèses défendues explicitement par l’écrivain: Claudie Bernard met en valeur les ambiguïtés, les glissements de sens, les recouvrements intertextuels qui caractérisent la problématisation romanesque de l’histoire. Enfin, le choix d’un corpus très divers par les formes littéraires qu’il mobilise, mais aussi par la notoriété des auteurs et l’impact effectif des romans sur le public, met en valeur des effets de reprise, d’opposition ou de dialogue sous-jacent, mais aussi la rupture radicale qu’instaurent certains textes très novateurs, voire expérimentaux.
Le sous-titre que Claudie Bernard a donné à son essai suggère, en creux, une réflexion relevant de l’histoire littéraire: les études se succèdent dans un ordre quasi-chronologique—par exemple, Sous la hache d’Élémir Bourges (1885) précède L’Insurgé, dont Vallès fit paraître une première version dans La Nouvelle Revue dès 1882. Cette perspective linéaire en pointillés n’est jamais explicite: au lecteur de tester (et de relativiser, voire d’invalider) les périodisations ordinairement en usage, qui notamment font de l’expérience traumatique de 1848 (février et juin) un tournant décisif dans l’appropriation romanesque de l’histoire. Ce que certains, dans la lignée de Lukacs, considèrent comme une dégénérescence du genre sous le Second Empire est aussi un laboratoire narratif où tentent de s’élaborer de nouveaux modes de saisie du devenir, dans des contexte de crise des valeurs et de remises en question radicales: discuté et repensé dès la Restauration, le modèle scottien fait l’objet d’une déconstruction critique, cependant que la figuration romanesque du sens de l’histoire constitue, autant que les thématiques abordées, le sujet même du récit.
Malgré la fonction idéologique et politique que les contemporains prêtent au roman historique du XIXe siècle, la variété du corpus envisagé par Claudie Bernard rappelle que ce type de texte n’est jamais réductible au discours qu’il tient explicitement, par intervention auctoriale ou par l’intermédiaire des personnages. Le roman historique est une forme-sens qui signifie aussi bien par sa poétique (système des personnages, confrontation des perspectives et des voix, affleurements et reconfigurations génériques) que par la dimension métalittéraire qu’il intègre à sa démarche propre, et qui déborde de beaucoup le paratexte et le discours d’escorte. En témoignent les cas-limites qu’explore Claudie Bernard: la nouvelle, par son esthétique de la concentration et du choc, appréhende le devenir selon une esthétique du laconisme, de l’ellipse, du non-dit; le roman historique fin-de-siècle cultive un art du second degré qui parasite l’effet de réel; avec L’Insurgé, Vallès fait du récit lui-même, instable et éclaté, une insurrection contre l’histoire et contre la littérature.
À suivre Claudie Bernard dans sa passionnante traversée du siècle, on est frappé par l’onde de choc que représente la Révolution française, dont procède, à en croire maints historiens et écrivains (au premier chef Hugo et Michelet), tout le XIXe siècle. Outre les fictions révolutionnaires proprement dites, qui lancent une investigation approfondie sur ce cataclysme fondateur, rares sont les récits qui ne s’interrogent pas sur ses origines lointaines ou proches, le nouveau régime d’historicité qu’elle induit, et l’élan démocratique qu’elle lègue, pour le meilleur et pour le pire, à la modernité européenne. Ce questionnement obsédant se cristallise sur la question de la violence, dans ses rapports avec la civilisation et avec le progrès: comment concilier les idéaux généreux des républicains de 93, ou l’humaniste universaliste des quarante-huitards, avec les rigueurs du gouvernement révolutionnaire ou le sang des journées de Juin? Comment défendre un modèle de civilisation où affleurent sans cesse la violence primitive et la brutalité de la bête humaine, appuyés sur d’impitoyables mécanismes de domination, d’assujettissement, d’anéantissement? Comment inventer des formes narratives inédites pour exprimer l’histoire alternative des possibles avortés, ou l’histoire effacée des vaincus?
Passionnant par la richesse suggestive de ses analyses, le livre de Claudie Bernard nous rappelle, avec son titre Si l’Histoire m’était contée, le pouvoir ambigu de la fiction. C’est dans “Le Pouvoir des fables” que La Fontaine insère le fameux distique que démarque l’auteure: “Si Peau d’âne m’était conté / J’y prendrais un plaisir extrême”. Or, cette fable est aussi un récit historique: elle met en scène, dans une Athènes bavarde et frivole, une philippique ratée et un Démosthène en mauvaise posture—l’orateur n’arrive à se faire entendre qu’en renonçant à la harangue au profit d’un “trait de fable,” qui éloigne son public de l’ordre du jour pour mieux l’y ramener. La fiction historique est certes divertissement, mais aussi instrument d’investigation dont l’objet est moins le passé que l’actualité qui nous sollicite, nous enserre et nous menace. “Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?”