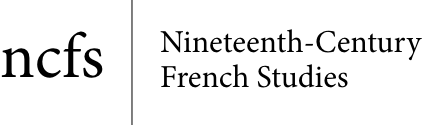Guibal on Berthier, Avec Stendhal (2012)
Berthier, Philippe. Avec Stendhal. Paris: Éditions de Fallois, 2012. Pp. 176. ISBN 978-2-87706-841-3
C’est un livre d’adieu que nous offre ici Philippe Berthier. Non qu’il ait fini, de son propre aveu, d’écrire “ici ou là” sur Stendhal; mais “plus de livre” (171). Avec Stendhal, c’est l’occasion de se retourner sur une soixantaine d’années de vie commune et de dire merci à un “vieux compagnon.” L’ouvrage se veut intime, voire intimiste, et trouve sa place dans la lignée de parutions récentes telles que les Portraits de Stendhal de Thierry Laget (2008). L’objectif de Berthier: “présenter la physiologie […] d’une identification littéraire” programmée par Stendhal lui-même (16), et découvrir le “je” trop longtemps enfoui du critique, libre à présent de le déployer à sa guise.
Deux niveaux de lecture se présentent alors au lecteur. Le premier, factuel, propose un portrait croisé de Stendhal et Berthier, à travers vingt-cinq (si l’on exclut l’introduction intitulée “C’est moi!”) petits chapitres présentant les deux hommes en des situations diverses, comme “À table,” “En politique,” “À l’Opéra,” etc. Après avoir exposé les attitudes et opinions de Stendhal dans un contexte donné, Berthier amène à son tour les siennes dans le sillage ou non de son prédecesseur. On apprendra ainsi que, sur la question de l’enfance et des relations familiales, Stendhal “demeure profondément étranger” à Berthier (39), mais que tous deux vantent à l’unisson les “bienfaits du voyage” (126-27). La liste des points de rencontre ou de divergence serait trop longue à détailler ici. Chaque chapitre nous renseigne cependant beaucoup plus sur Stendhal que sur Berthier lui-même, et soixante années de fréquentation assidue d’un auteur permettent à ce dernier de nous offrir une succession de petits portraits “en situation” fort agréables à lire. On regrette seulement que l’équilibre impliqué par le titre n’ait pas été suivi, et que la coupure soit trop nette entre Stendhal et l’auteur, qui souvent se contente de clore le chapitre avec une formule du type “Quant à moi, je…” On ne saurait pour autant lui en faire grief; dur d’être égotiste après Stendhal. Seul le chapitre “Avec Dieu” paraît atteindre l’entrelacement idéal des deux voix qu’on aurait pu s’attendre à trouver tout au long de l’ouvrage. S’il faut être pointilleux, relevons deux autres petits bémols qui viennent entacher (sans rien lui enlever) ce petit livre d’au revoir plus que d’adieu: le “Dr Sanfin” de Lamiel (25) au lieu de “Sansfin,” et “le saint Jean l’Hospitalier de Flaubert” (60) au lieu de “saint Julien.”
Le second niveau de lecture, plus pertinent à notre goût, est aussi plus polémique. Berthier aurait en effet pu commencer son livre de la même façon que Stendhal ouvrait sa Vie de Napoléon: “J’écris […] pour répondre à un libelle.” Sont explicitement visés ici les récents refondateurs autoproclamés du légendaire “Stendhal Club,” et dont il semble que ce soient la “condescendance,” voire le “mépris” revendiqués, ainsi que la “violence et la trivialité de cette animosité antiuniversitaire” (12, 13), qui ont décidé Berthier à prendre la plume (“[N]ous tenons la plume d’une main et l’épée de l’autre,” disait Henry Brulard). C’est à notre avis en cela avant tout que Berthier est avec Stendhal: le polémiste, réagissant à chaud à l’actualité, lance une contre-attaque dont l’esprit et la légèreté sont renforcés par un solide sens de la formule. Et en fait d’épée, une petite pique au milieu du livre nous rappelle la teneur “polémique” de ce texte, au cas où on l’aurait oubliée: “[L]e Stendhal Club […] n’a jamais existé” (109). À bon entendeur.
C’est un dernier ouvrage tout à fait plaisant et enrichissant que nous propose ici Berthier. Bien que ne se considérant pas comme écrivain (127), il a plus d’une fois montré, par son style et son lyrisme, que la frontière entre “ouvrage critique” (bien que techniquement celui-ci n’en soit pas un) et “œuvre” peut être tout de même assez fine, comme en témoigne le passage suivant, à propos de sa petite ville natale: “[A]ujourd’hui bien déchue, elle se meurt doucement en ruminant le souvenir de ses grandeurs passées. Quiconque n’a pas, un jour d’hiver, parcouru ses rues désertes, ignore ce que peut être la tristesse” (134).