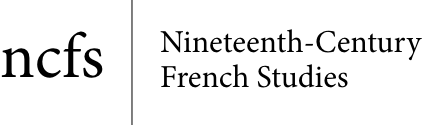Bertran de Balanda on Girault-Fruet (2020)
Girault-Fruet, Arlette. Mers intérieures: Chateaubriand, la mer et les Mémoires d’outre-tombe. Classiques Garnier, 2020, pp. 361, ISBN 978-2-09611-5
Chateaubriand le marin, le navigateur des confins, l’explorateur, le fier Malouin, le contemplateur solitaire des flots en furie : ces images d’Épinal sont d'autant plus connues que, dans les faits, l’Enchanteur vécut de façon bien plus terrestre qu’il ne voulut l’avouer. La mer comme motif topique de son œuvre et des Mémoires d’outre-tombe en particulier a également nourri bien des études; l’originalité de celle d’Arlette Girault-Fruet, qui dresse du reste un état de l’art exhaustif sur la question, réside précisément dans une parfaite connaissance de ses prédécesseurs et dans l’élaboration d’une exégèse neuve et originale, au double sens de l’épithète.
Le postulat est beau et simple: le bruit de la mer formerait comme la musique des Mémoires, fond rythmé et doux tel qu’on l’entend, pour reprendre la métaphore heureuse de l’auteur, dans les coquillages. “Respiration” du texte, elle serait également celle du narrateur, à tel point qu’il deviendrait difficile “de savoir si c’est le voyageur qui écrit la mer, ou si c’est la mer qui révèle le voyageur” (10). D’où l’idée d’une mer sise au plus profond du psychisme de Chateaubriand, intériorisée, travaillée à son image jusqu’à en faire une “mer en soi,” d’un paysage maritime mental en somme, n’excluant pas que la mer cumule le statut de refuge, de protagoniste, y compris de nourrice ou de maîtresse.
L’essai se distribue en trois sections, nous proposant chacune un angle différent pour tenter cette cartographie d’un océan littéraire. La première, “Une relation au long cours,” présente l’autobiographie comme un récit de vie dont le fil directeur est la présence maritime. Né lors d’une tempête et comme enfanté par elle, l’écrivain se définit par Saint-Malo, ce rocher où il a vu le jour et auquel il ne cesse d’envisager de revenir sans y parvenir tout en se définissant comme “îlien.” Ce motif insulaire complète ainsi l’imaginaire pélagique, avec le mythe notamment de “l’île des femmes” (80 sq.). Si la mer est femme, l’île l’est tout autant, brouillant le rapport entre la “femme/île” et l’“île/femme.” D’un côté Venise par exemple, beau corps féminin lascif, de l’autre les sylphides, ces jeunes filles auxquelles la proximité des flots donne un surcroît d’érotisme. Mais le roc battu par les flots est également sépulture choisie de son vivant, isolée comme celle des conquérants, ne gardant de la mort que son caractère apaisant : “le Grand Bé n’est pas la rive oublieuse, ni le constat d’une absence, mais l’Ultima Thulé, le point extrême d’une navigation audacieuse, un au-delà érigé simultanément en absolu et en propriété privée, compris comme l’apothéose du naufragé, désormais protégé par l’île, et de nouveau bercé par la mer, rendu à sa tendresse” (104).
La deuxième partie, “Lignes d’horizon,” déplace la focale sur les trois personnages que Chateaubriand entend avoir incarné—une fois de plus davantage dans ses projets avortés et dans la représentation qu’il donne de soi que dans sa vie réelle—soient respectivement le marin, le découvreur et le voyageur. Pour ce faire, il établit un double dispositif: d’une part, s’insérer dans la tradition littéraire dépeignant l’homme de mer comme un être à part, plus tout à fait humain, gagné en quelque sorte par l’élément aquatique; d’autre part, se présenter d’abord comme naturellement à l’aise parmi cette espèce, fraternellement adopté en retour, pour devenir, selon sa propre expression qui forme le titre d’un chapitre éponyme, un “Barbare d’Armorique” (159 sq.). Le voyage, enfin, peut demeurer intérieur; A. Girault-Fruet en donne une fine analyse: “le voyage devient la poursuite, fréquemment déçue, de sensations encore inéprouvées, et de moins en moins faciles à éprouver. Le rythme accéléré sur lequel Chateaubriand se déplace souvent se justifie en grande partie par cette recherche d’un pays où il n’arrive jamais, d’une mer intérieure définitivement située à l’ouest de nulle part” (239).
Dans un troisième et dernier moment, c’est l’idée d’une “écriture marine” qui est posée, interrogeant le degré jusqu’auquel la mer s’invite dans l’acte même d’écrire. Le rythme, ses brisures, ses digressions composent un style caressé par les vagues : “le flux des marées et le flux du temps paraissent dessiner de manière presque identique l’estran où s’inscrivent aussi bien l’histoire de la mer que l’histoire de la vie” (304). Ce dernier tiers de l’essai, comme porté par les deux précédents, se veut résolument ambitieux—défi du reste réussi—inscrivant le caractère pélagique des Mémoires selon un axe de coordonnées. D’un côté, se constituent des “laisses de souvenirs, qui reproduisent la formation des laisses de mer,” tandis que de l’autre “[les] hantises de Chateaubriand … traversent le récit comme le feraient des trains de houle.” Résultat: une “impression diffuse et persistante [chez le lecteur] que l’écriture épouse la mémoire et la respiration des vagues” (309).
On retiendra de cet ouvrage à la fois érudit et d’une lecture des plus agréables les pistes de lecture inédites qu’il ouvre, et confirme s’il était besoin que François-René, dont on pourrait penser que son œuvre comme sa vie ont été disséquées à l’envi, demeure une mine précieuse que le critique n’a pas fini de creuser, débusquant des galeries nouvelles et arrachant de leurs parois des joyaux inattendus. Quant à cette mer intérieure dont le ressac tapisse l’esprit de l’auteur, est-elle si enfouie et si fantasmée? Une des conclusions parmi les plus pertinentes proposées par cette étude élargit la question à celle des grands espaces: synonyme d’immensité et d’éternité, la mer se constitue comme champ sans fin et sans fond, comme étendue dont l’ampleur était sans doute la seule à pouvoir contenir l’envergure et la puissance d’un souffle d’écriture qui entendait bien braver les siècles.