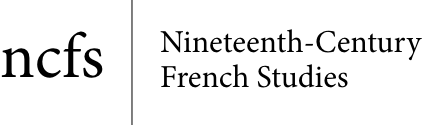Bertran de Balanda on Schuerewegen (2018)
Schuerewegen, Franc. Le Vestiaire de Chateaubriand. Hermann, 2018, pp. 245, ISBN 978-2-7056-9725-9
À la lecture du titre de l’ouvrage de Franc Schuerewegen, on serait en droit de s’attendre à une exégèse des notes de blanchisserie de Chateaubriand comme cela a pu être le cas pour Baudelaire, l’un comme l’autre prisant le goût que l’on sait pour une élégance militante. Le propos de cet essai passionnant et stimulant est plus ambitieux, qui met en quelque sorte à nu l’Enchanteur en le dépouillant de ses oripeaux textuels plus que textiles. Se plaçant sous le patronage de Roland Barthes, Gérard Genette et Jean-Pierre Richard, l’auteur propose une analyse postextuelle, ainsi qu’il l’avait déjà fait pour Marcel Proust, de l’œuvre du Malouin décrite comme un palimpseste. Elle est en effet présentée comme un emboîtement de non-dits, soit qu’ils seraient dits plus tard par d’autres—Proust et Baudelaire toujours—, soit que d’autres n’aient su le dire—Balzac—, soit encore qu’on se refuse à ce que d’autres l’aient dit —Byron—, soit enfin qu’un en-deçà du sens sature paradoxalement la signification—voir le chapitre “Chats (Barthes),” avec d’intéressantes mises en abyme enchâssant l’animal, le sobriquet donné à l’écrivain dans le cercle des amis de Pauline de Beaumont et sa signature souvent abrégée. Le dispositif autobiographique et ses vacillements au gré de ses énonciations successives est encore brouillé par les métaphores, telle celle du nageur entre les berges de l’Histoire, qui agissent comme d’autres formes d’autodésignation “littérarisant” le sens figuré (114). Le littéral et le figuré sont en outre volontiers réversibles, tel ce vestiaire annoncé auquel est bel et bien consacré un chapitre éponyme, véritable “système vestimentaire” (158) par lequel l’écrivain, via son œuvre, crée son propre musée.
D’autres confusions fécondes surgissent, repérables par tel trope, ainsi l’effet de métalepse qui, faisant précéder le son du canon de Waterloo par la lecture de De Bello Gallico, commence la bataille dans la lecture de César avant de la rendre réelle: ce faisant, “l’auteur des Mémoires rend hommage aux pouvoirs de la littérature, à la force de la représentation” (183). Ailleurs, c’est la paralipse qui révèle les strates cachées de l’écriture de soi; au rythme d’une enquête policière, dont on peut dire que chaque chapitre en forme une nouvelle enrichie des conclusions des précédentes, Schuerewegen interroge le destin littéraire de Francis Tuloch à la façon d’Agatha Christie—chapitre “Zigouiller (Tulloch).” Comment et pourquoi ce compagnon de route du voyage en Amérique, lié à René par un pacte quasi faustien, disparaît-il brutalement de l’épopée pour réapparaître contre toute attente à Londres en 1822, avant de disparaître à nouveau, définitivement et plus mystérieusement encore? Poussant jusqu’à l’hypothèse d’un gender switch amoureux ponctuel (197), l’auteur déduit une forme de crime littéraire, dont l’assassin se garde de livrer les ficelles au lecteur, tout en laissant suffisamment d’indices rendant possible a posteriori leur reconstitution. La puissance de l’écriture est donc dévorante, elle consume ses objets pour mieux les immortaliser (208).
Les Mémoires d’outre-tombe, nous est-il rappelé, étaient initialement censées s’intituler Mémoires de ma vie; de ce basculement sémantique radical, de cette énantiosémie découle un étonnant jeu d’équivalence entre les deux signifiants, qui doit être en permanence retenu: “Quand Chateaubriand écrit la mort, nous entendons la vie” (209). Parlant de son vivant mais depuis son tombeau à un lectorat qui sera posthume, Chateaubriand ne cesse d’enchaîner les situations de demi-mort, de mort différée, de “mort typographique” (219), voire de mort cyclique dans chaque “ blanc interchapitral ” (223), prélude à chaque fois à une nouvelle naissance/renaissance. L’étrange et incessant va-et-vient entre éros et thanatossuggère même dans le même chapitre—judicieusement nommé “Zéro mort (ou l’art de ne pas mourir tout de suite)”—la possibilité d’un fantasme érotique chez le mémorialiste, celui d’“embrasser la mort sur la bouche,” de la “baiser”; soit, selon l’acception et le registre choisis, d’échanger avec elle un “French kiss”—registres soutenu et courant—, de lui faire l’amour—registre trivial–, ou, enfin, de la duper—même registre (218–19). On assisterait en somme à une vaste mise en scène multiscalaire et vertigineuse, celle d’une mort qu’on ne cesse d’annoncer dans une alternance, ou plutôt une superposition du tragique et du ludique, par une suite de scènes—au sens théâtral autant qu’à celui de scénarios—parcourant les Mémoires synchroniquement plus que diachroniquement, et qui, précisément par cette distorsion de la chronologie, autorisent la peinture d’une vie.
La conclusion reprend le tryptique intentio auctoris/intentio operis/intentio lectoris d’Umberto Eco, en nous mettant en garde quant à ce qu’on peut réellement saisir de la première, puisqu’elle est décrétée par la dernière. L’objectif du critique est dès lors moins de débusquer le sens d’une œuvre, dont chacun sait depuis Paul Valéry que chaque lecteur et chaque lecture sont libres d’en faire naître un nouveau, que de poser des pistes susceptibles de faire émerger son fonctionnement. Nous sommes cependant fort loin de la vulgate structuraliste entendue comme l’autonomie d’un texte devenant autorité surplombante tout en émanant in fine de la subjectivité de celui qui l’aura décrétée: aussi une nouvelle ligne intentionnelle est-elle mobilisée, celle de l’intentio civitatis, qui implique partage et dialogue avec la communauté scientifique. Dialogue qui commence bien souvent par la contradiction, et qui justifie ainsi pleinement le caractère volontairement intempestif des rapprochements inattendus et des anachronismes provocateurs qui ont jalonné le livre, et qu’on est d’ores et déjà tenté de relire non plus pour en sourire ou s’en offusquer, mais pour les mettre à profit comme autant de voies ouvertes à une autre relecture, celle d’un Chateaubriand pris à rebours, traqué dans la vérité de ses mensonges et vice-versa, encouragées par ce statut pionnier de “première autofiction” (235) dont se voient gratifiées les Mémoires. Si ces dernières revêtent un caractère plus précurseur qu’on ne l’eût pensé, ce sont donc à des travaux d’un genre nouveau, tout aussi rigoureux que potentiellement iconoclastes, que nous voilà invités.